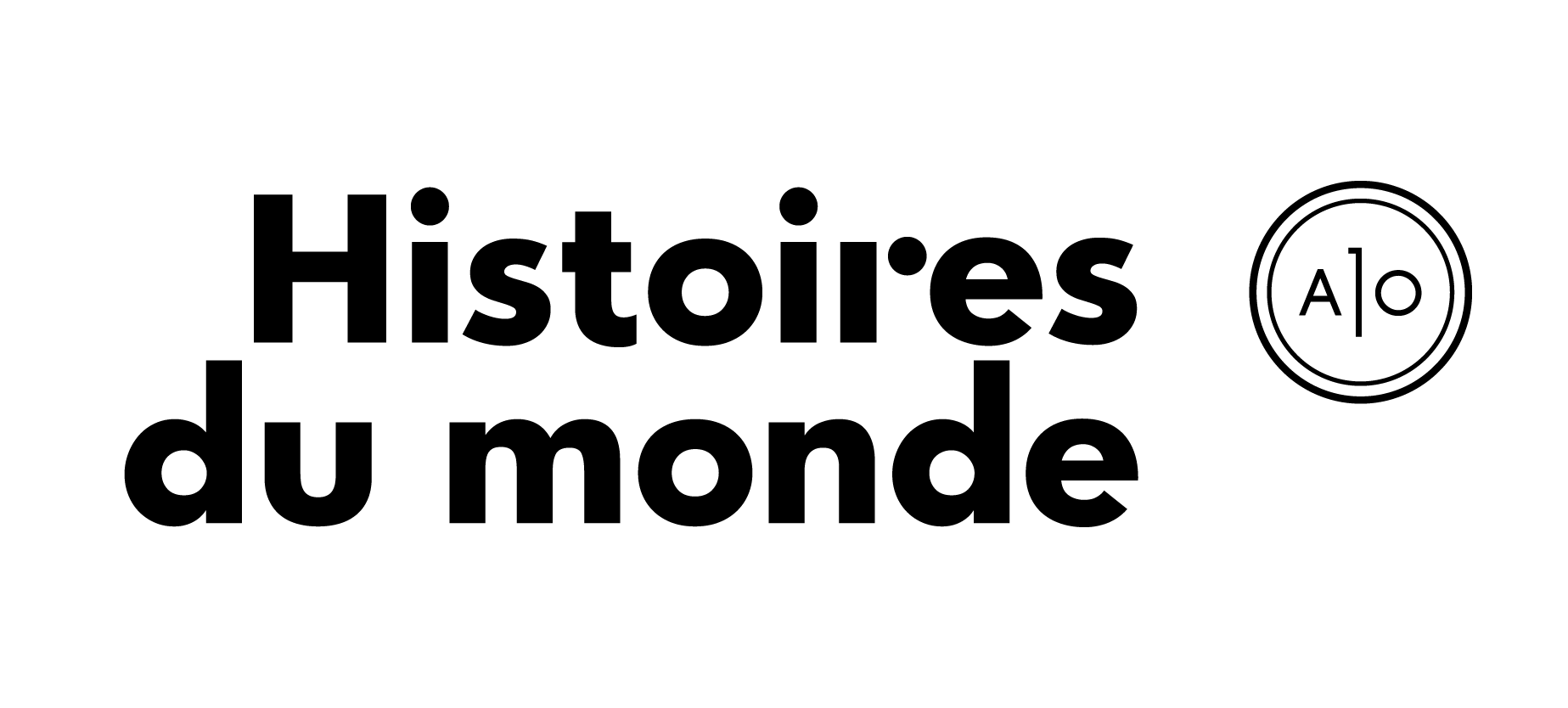Infirmière de colonie - L'Histoire de Marie-Berthe Prévost
J’ai vécu cent ans. Cent ans, j’en suis la première étonnée et j’en ai bien profité.
J’ai eu une vie heureuse et remplie de tout ce que j’aime : des voyages, des soirées à la campagne, une bonne instruction au couvent où j’ai appris tant de choses et un travail d’infirmière qui m’a passionnée. Jusqu’à la fin, j’ai eu la chance d’être lucide. Je n’ai pas eu d’enfant, mais j’ai été aimée et très entourée.
J’ai grandi à Montmagny, près du fleuve, dans une magnifique maison avec nos parents, ma sœur et mes quatre frères. Mon père et ma mère savaient jouir de la vie. Ils organisaient souvent des réceptions. Dans l’immense salon, on s’adonnait aux danses de l’époque. Antoinette Tremblay, la femme du gérant de la compagnie Price, venait jouer du piano. Nous, les enfants, nous assistions à ces soirées cachés dans l’escalier.
Je jouais souvent chez la voisine, mon amie Élizabeth Côté. Je restais parfois chez elle pour la prière du soir. De retour à la maison, mes parents exigeaient que je la refasse avec ma famille. J’avais beau protester : « J’ai fait ma prière chez les Côté », rien à faire, je devais recommencer. Les Côté avaient une douzaine d’enfants. Je me rappelle les corvées de repassage. Toutes les filles s’y mettaient. Sur la grande table, elles repassaient avec les fers lourds de l’époque.
En 1921, ma petite sœur, Rachel, est morte à l’âge de sept ans de la grippe espagnole[1], tout comme une autre élève de sa classe. Au couvent Saint-Cœur-de-Marie que je fréquentais à L’Ancienne-Lorette, nous avons été épargnées. Malgré deux cérémonies d’extrême-onction, aucun décès n’a été signalé parmi la centaine d’élèves et les religieuses.
Rachel était une petite fille brillante et douce. Mon père, Joseph, a beaucoup pleuré son décès. Il a donné tous les jouets de ma sœur pour ne plus les voir. Un jour, en visite chez des amis, il s’est effondré en larmes en voyant une petite table qui avait appartenu à ma sœur. Lorsque, quelques années plus tard, j’ai moi-même été hospitalisée à l’hôpital Jeffery Hale pour une péritonite, mon père veillait à mes côtés. Je me souviens de l’avoir vu pleurer toute la nuit avant mon opération. Comme il n’avait pas eu de sœur, il était très fier de ses deux filles.
Des parents tendres et aimants
En homme tendre, mon père embrassait ses enfants et il était très gentil avec eux. Il s’approchait de ma mère en disant : « Ma petite femme », avant de l’enlacer et de l’embrasser. Issu d’une famille de huit garçons, il avait été entraîné très jeune à aider sa mère dans les tâches domestiques, une habitude qu’il a conservée avec son épouse.
Avant de marier mon père, ma mère, Zéolide, était institutrice. C’était une femme adorable qui n’aimait pas faire la cuisine ni tenir une maison. Dès qu’un domestique savait cuisiner, elle en profitait pour lui déléguer ces tâches et vaquer aux occupations qu’elle préférait : lire et broder. Lorsque je revenais du couvent le vendredi soir pour la fin de semaine, j’enfilais un tablier et je préparais le souper pour toute la famille. J’aimais beaucoup cuisiner, au grand bonheur de ma mère. J’ai appris la cuisine et la couture dès la cinquième année à l’école. À l’âge de 15 ans, j’ai pour la première foi fait moi-même mon manteau et j’ai continué toute ma vie, ou presque, à les fabriquer.
Zéolide détestait également jouer aux cartes, mais elle s’obligeait à le faire. En tant qu’épouse d’un homme important de la région, elle devait participer à la collecte de fonds pour les organismes de charité ou pour l’hospice alors dirigé par les Sœurs Grises.
Mon père possédait une compagnie de fabrication de boissons gazeuses et d’eau embouteillée. À l’époque de la prohibition[2], l’alcool étant interdit, Joseph avait mis au point une boisson sans alcool à saveur de bière, ce goût était très recherché. J’ignore si c’était par simple jalousie, mais le conseil de ville avait voté une résolution contre la boisson à la bière de mon père. Très en colère, Joseph avait fermé ses portes pour s’installer à Québec, où il avait fondé une entreprise de meubles spéciaux sur commande. Il y fabriquait des confessionnaux dont certains modèles pliants pouvaient être rangés au besoin.
Joseph était un homme juste qui traitait bien ses employés. Lorsque les revenus étaient plus limités, il versait d’abord leur salaire à ses employés, puis se payait avec ce qui restait. On m’a aussi raconté que lorsque son contremaître a souffert de tuberculose, mon père lui a versé son plein salaire pendant quatre ans et il allait le visiter de temps en temps.
Un jour, un client a payé Joseph en lui donnant une vache. Comme il n’y avait pas d’espace pour l’animal chez nous, cette dernière fut confiée à l’hospice, où il y avait déjà quelques bêtes. Nous allions y chercher notre lait, prenant juste ce dont la famille avait besoin, et nous laissions le reste pour les résidants de l’hospice.
À l’époque, un hospice était une résidence pour aînés dirigée par des religieuses. Les hommes et les femmes y étaient séparés, même s’ils étaient mariés. Un jour, à Montréal, une administratrice a fait scandale en plaçant des couples ensemble. Peu à peu, les pratiques ont évolué et on a cessé de séparer les couples dans ces maisons pour aînés.
Une belle et longue amitié
J’ai connu ma meilleure amie, Simone, au couvent Saint-Cœur-de-Marie, où j’ai fait tout mon primaire. L’institution était dirigée par des religieuses venues de France, des femmes intelligentes. Simone Schiller était une descendante du poète allemand Schiller, un ami de Goethe. Son père, un médecin, avait mis au monde mes frères Eddy et Roland.
Simone fut mon amie jusqu’à sa mort, vers l’âge de 80 ans. C’est par ailleurs son mari qui a fait en sorte que mon petit frère échappe aux combats pendant la Seconde Guerre mondiale, en s’organisant pour que Paul travaille plutôt dans les bureaux de l’armée.
À la fin de l’adolescence, j’ai subi une opération et on m’a dit que je ne pourrais pas avoir d’enfant. J’ai cru pouvoir devenir sœur, mais la vocation religieuse n’était pas pour moi. Au début de la vingtaine, j’ai tout de même fait mon noviciat dans la région de Winnipeg avant de me rendre compte que j’allais faire autre chose de ma vie.
Tout comme mon frère Eddy et mon neveu Denis, j’ai hérité des talents artistiques de la famille de ma grand-mère Labonté, la mère de mon père. Sa famille comptait de nombreux artistes, des peintres et des dessinateurs, dont trois avaient étudié à l’École des beaux-arts de Paris.
Comme j’étais habile de mes mains, j’ai d’abord gagné ma vie comme artisane. Je peignais, je travaillais le cuir et l’étain repoussé, je fabriquais, entre autres, des reliures de livres et des boîtes cadeaux. Au début des années 1940, avec la guerre, les gens avaient moins d’argent pour les objets que je fabriquais et il est devenu difficile de m’approvisionner en matériaux. J’ai donc dû me réorienter.
Une infirmière de colonie dévouée
J’ai alors entrepris des études d’infirmière à l’hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc. À peine sortie de l’école, j’ai obtenu le poste d’infirmière de colonie[3] au dispensaire de Destor, en Abitibi. Une voiture de fonction était fournie avec l’emploi, mais je ne savais pas conduire. La veille de mon départ, un médecin m’a donc appris à tenir un volant et j’ai pris la route dès le lendemain pour l’Abitibi. C’était le 16 juin 1943.
Je logeais au dispensaire, dans une petite maison en bois mal isolée où il pleuvait à l’intérieur et où il faisait froid l’hiver. Comme il n’y avait pas l’eau courante, il fallait aller la puiser à la rivière[4]. Mes patients provenaient des trois rangs voisins, je m’occupais d’une soixantaine de familles qui comptaient parfois jusqu’à six, sept ou huit enfants. L’hiver, il m’arrivait de devoir me déplacer en raquettes et l’on venait même parfois me chercher en traîneau à chiens pour que je puisse atteindre les maisons de mes malades.
J’étais très respectée par les gens de la région. J’ai accouché trente-cinq bébés et soigné deux fausses couches. Je travaillais avec une assistante choisie dans les rangs. J’étais mieux payée que les infirmières des hôpitaux de la ville. Mon salaire était de 80 $ par mois et pouvait aller jusqu’à 90 $ ou 100 $, alors que mes collègues des hôpitaux gagnaient entre 45 $ et 50 $ par mois.
Découverte des voyages
En 1946, je suis retournée à Montréal pour prendre soin de ma mère, Zéolide. Le jour, je travaillais à l’unité sanitaire de l’île Jésus auprès des enfants dans les écoles et des femmes qui venaient d’accoucher. J’avais aussi un autre emploi le soir, à l’hôpital Sainte-Justine. En 1950, épuisée, j’ai pris un congé de trois mois pour voyager en Europe.
Peu de temps après, j’ai fait l’acquisition d’un chalet au lac Michaudville, près de L’Annonciation. L’endroit a été mon refuge le week-end et mon lieu de vacances, bref mon grand bonheur pendant 27 ans. J’aimais y cueillir des champignons, des bleuets et des framboises, pour ensuite les cuisiner.
Le terrain faisait partie des terres récemment ouvertes à la colonisation dans les Laurentides. Je l’ai obtenu pour une bouchée de pain, soit environ 200 $, une somme dérisoire, même à l’époque. Au début, les chemins n’étant pas construits, on devait s’y rendre en chaloupe. J’y ai fait bâtir un deuxième chalet qui appartenait officiellement à mon frère Paul et que j’ai loué à des familles au fil des ans.
J’y ai aussi construit une serre démontable, avec des lattes de bois attachées par des petits crochets. Elle était recouverte de plastique de construction qui était retenu au sol par des roches. J’y ai fait pousser des tomates, des haricots, des laitues et de la ciboulette.
J’ai toujours été très économe et astucieuse. Avec la revente de mon chalet dans les années 1980 et ma couture, j’ai économisé une somme suffisante pour être investie. Une fois à la retraite, vers l’âge de 66 ans, j’ai payé mes nombreux voyages avec les intérêts touchés sur mes placements.
Certains disaient que je n’avais pas froid aux yeux, car je voyageais seule. Pour une femme de mon époque, c’était plutôt rare. À mon premier long périple, je suis partie en bateau avec un minimum de bagages : un tailleur dont je changeais seulement le chemisier et une robe plus chic pour les sorties spéciales.
J’ai ainsi visité la France, l’Italie, l’Autriche, l’Espagne, Israël, l’Égypte et le Pérou. Grâce aux lettres de recommandation que me fournissaient les religieuses, je pouvais dormir dans les couvents. Je trouvais le lieu économique et sécuritaire. À l’âge de 80 ans, je me suis rendue seule en Allemagne pour visiter ma nièce Louise.
Mon plus beau souvenir de voyage demeure Aïda, lors de mon premier séjour en Europe. C’était joué dans les Thermes de Caracalla, à Rome, en plein air, de 21 heures à 2 heures du matin, avec de véritables chevaux et un chant splendide. Un vrai rêve !
Une centenaire heureuse
Je suis plutôt surprise d’avoir vécu si longtemps, car, toute ma vie, j’ai eu plusieurs problèmes de santé, dont la dégénérescence maculaire qui m’a pratiquement rendue aveugle.
Lorsque j’ai eu 95 ans, on a détecté une tumeur à mon intestin. Vu ma détermination et ma résilience, mon médecin, qui jugeait généralement risqué d’opérer une dame d’un si grand âge, m’a dit qu’il était prêt à faire une exception pour moi. Je lui ai répondu : Faites votre job et je vais faire la mienne. Il m’a donc opérée, j’ai vécu cinq années de plus et j’ai pu voir le premier président noir élu à la Maison-Blanche, ce qui m’a rendue très fière.
En janvier 2009, j’ai atteint l’âge vénérable de 100 ans. Mes neveux et nièces m’ont alors organisé une immense fête. J’y ai revu ma vie en photos et en témoignages, c’était formidable. Je ne suis pas la seule centenaire de la famille. Chez les Lavoie, la famille de ma mère, on en compte trois. Marie-Louise, une cousine de ma mère, Zéolide, a même vécu de façon très lucide jusqu’à l’âge de 103 ans.
Quelques mois plus tard, comme je me sentais fatiguée, j’ai confié à mes proches que je ne vivrais plus très longtemps. Je leur ai dit à la blague que le bon Dieu m’avait oubliée. Je leur ai aussi dit que j’avais fait une bonne vie.
Berthe Prévost s’est éteinte à l’hôpital Charles-Le Moyne le 27 mai 2009
Propos recueillis par Louise Prévost
[1] En 1918-1919, le Québec fut la province la plus durement frappée par la pandémie de grippe espagnole, surnommée « la grande tueuse ». Avec 14 000 décès, peu de familles québécoises ont été épargnées.
[2] En 1920, les États-Unis votent en faveur de la prohibition de l’alcool. Le Québec abolit cette prohibition un an plus tard. Outre quelques municipalités réfractaires, la province est alors le seul endroit en Amérique du Nord où l’alcool n’est pas criminalisé.
[3] Pendant les années 1930, le gouvernement du Québec établit, sur des terres ouvertes à la colonisation, des familles frappées par la crise économique. Afin d’assurer un minimum de services de santé à ces colons, il décide de construire des dispensaires et d’y installer des infirmières dites « de colonie ». Ces dernières pratiquaient des accouchements et devaient fournir un service médical aussi complet que possible.
[4] Berthe Prévost a été la septième infirmière sur les douze qui ont occupé le poste de Destor. En 1941, le Dr Martel, directeur du Service Médical aux Colons, jugeait ce dispensaire inhabitable, car il y pleuvait à l’intérieur. Ces problèmes pourraient expliquer les changements fréquents d’infirmières à Destor avant 1953. Le dispensaire a été isolé en 1954. Source : Infirmières de colonie, par Nicole Rousseau et Johanne Daigle – Presses de l’Université Laval.
Marie-Berthe Prévost | 6 janvier 1909 - 27 mai 2009
Père : Joseph Prévost
Mère : Zéolide Lavoie
Frères : Léo Paul Prévost, Roland Prévost, Eddy Prévost, René Prévost
Sœur : Rachel Prévost